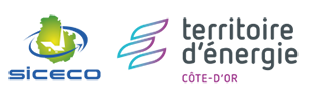Le budget vert est une méthode d’analyse des dépenses publiques qui vise à évaluer leurs impacts sur l’environnement. Cet outil budgétaire permet de mieux orienter les politiques publiques vers des objectifs de développement durable.
La France est le premier pays au monde à avoir introduit, dès 2020, le budget vert. Ce dernier s’inscrit dans une logique de transition écologique, en intégrant l’environnement au cœur des décisions budgétaires.
L’article 191 de la Loi de finances pour 2024 oblige les collectivités de plus de 3 500 habitants à le mettre en œuvre dès 2024.
Le budget vert, un outil de transformation de l’action publique
Le budget vert a pour objectif de mieux prendre en compte les considérations climatiques et environnementales dans les outils d’évaluation des politiques publiques et des budgets. Il permet ainsi de :
- Identifier les mesures les plus efficientes pour atténuer les impacts du changement climatique
- Evaluer les véritables coûts et avantages des projets, des programmes et des politiques
- Intégrer les outils verts dans les processus décisionnels existants pour garantir que les mesures vertes sont économiquement viables et socialement équitables
- Développer de nouveaux indicateurs pour mesurer les progrès et l’efficacité des politiques et des programmes verts
Pour résumer, le budget vert vise à recentrer les ressources sur des projets à fort impact positif (mobilité douce, rénovation énergétique, biodiversité, etc.) tout en réduisant les financements nuisibles à l’environnement. In fine, l’objectif est d’identifier les marges de progression et de mieux orienter les politiques publiques vers la neutralité carbone à l’horizon 2050.
Comment bâtir un budget vert ?
Sur le papier, la construction du budget vert repose sur une analyse qualitative et/ou quantitative des dépenses publiques. Celles-ci sont classées selon leur impact environnemental :
- Favorable
- Neutre
- Défavorable
En pratique, il n’existe pas de référentiel spécifique aux collectivités. Le SICECO a donc basé son analyse en appliquant la méthodologie I4CE. I4CE est elle-même issue du référentiel « Taxonomie européenne ».
Un résultat en demi-teinte
Sachant que la Taxonomie européenne a défini l’ensemble des travaux sur le réseau électrique comme neutres et que les travaux générant des économies d’énergie sont classés « favorables » sans lien avec les émissions de CO2, alors cette analyse appliquée au compte administratif 2024, fait apparaitre que :
- 48,01 % des dépenses sont favorables => ce sont les travaux de rénovation de l’éclairage public et les aides apportées à la rénovation des chaudières et du bâti des Communes et EPCI adhérents,
- 48,21 % des dépenses sont neutres => ce sont les travaux sur le réseau électrique,
- 3,21 % de dépenses sont défavorables comme l’achat de carburant diesel et essence (tous les véhicules ne sont pas encore remplacés).
Si l’on s’en tient à cette analyse, la marge de progrès ne concernerait que les dépenses défavorables représentant seulement 3,2 % des investissements, ce qui ne reflète pas la réalité.
En effet, les travaux sur le réseau électrique sont loin d’être neutres : il convient de travailler sur la décarbonation de la mise en œuvre portant principalement sur les véhicules et engins de chantier, les matériaux de remblaiement des tranchées et les matériels achetés tels que les câbles, très chargés en CO2. Ce travail commence avec les acteurs des travaux publics, l’association Ecorse TP et les fournisseurs.
De même, les travaux de rénovation de l’éclairage public n’ont que peu d’effet en matière de CO2 puisque l’économie d’énergie en installant des Leds ne porte que sur la période réduite de fonctionnement en début de nuit l’hiver, la plupart des communes pratiquant l’extinction nocturne, et du fait de la très faible charge en CO2 de l’électricité en France. Par ailleurs la mise en œuvre des travaux nécessite également de décarboner les matériels achetés et les engins.
Il est donc nécessaire d’évaluer les impacts carbone des investissements décidés par le SICECO, de les hiérarchiser et d’en tenir compte pour d’éventuelles priorisation.
Aller plus loin
Au vu de ce premier exercice « budget vert », le Comité syndical a décidé d’aller plus loin, considérant que la méthodologie recommandée comporte des limites et n’est pas assez précise en matière d’évaluation des impacts carbone. Il souhaite faire évoluer l’évaluation des activités du SICECO afin de pouvoir effectivement mesurer chaque année, les progrès en matière d’évolution de pratiques moins émissives en CO2. Cette nouvelle approche doit permettre d’analyser à nouveau le compte administratif 2024, comparativement à la méthode initiale I4CE, pour être à nouveau mise en œuvre lors du vote du compte administratif 2025 en mars 2026. Restera à vérifier si des progrès ont été réalisés entre les dépenses 2024 et 2025.